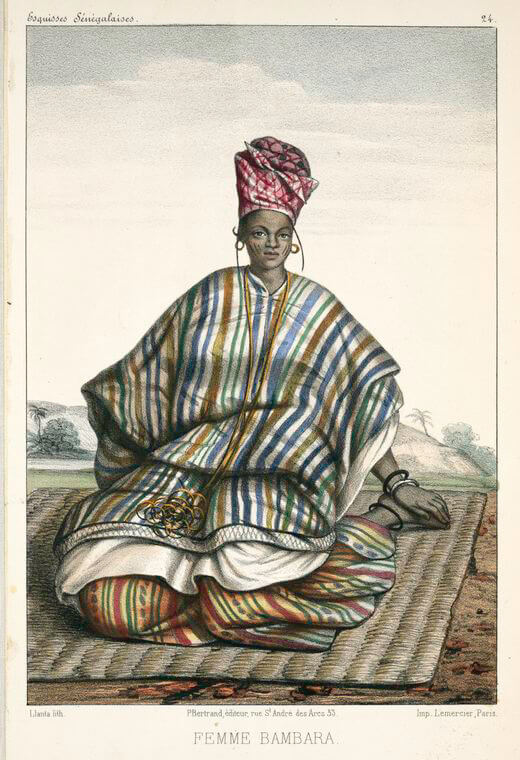Le bambara fait partie du continuum linguistique mandingue qui a prospéré sous l'Empire médiéval du Mali (13e-17e siècles), l'un des États les plus riches et les plus puissants de l'histoire africaine. Le légendaire Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali, parlait une langue mandingue, et l'épopée de Soundiata reste centrale dans la tradition orale bambara.
Après le déclin de l'Empire du Mali, le peuple bambara a établi de puissants royaumes à Ségou et Kaarta aux 17e et 18e siècles. Ces royaumes maintenaient des structures militaires et administratives sophistiquées et jouaient des rôles cruciaux dans les réseaux commerciaux régionaux avant la colonisation française.
Comme les autres peuples mandingues, la culture bambara est riche en tradition orale maintenue par les jeliw (griots) - des bardes héréditaires qui préservent l'histoire, la généalogie et les connaissances culturelles à travers la musique et les récits. La kora, le balafon et le ngoni sont des instruments traditionnels qui accompagnent ces narrations.
Depuis l'indépendance du Mali, le bambara est passé d'une langue régionale à une lingua franca nationale. Il est de plus en plus utilisé dans l'éducation, à la radio, à la télévision et dans la littérature. La langue s'est également adaptée aux contextes modernes, intégrant un nouveau vocabulaire tout en maintenant ses fondements culturels.